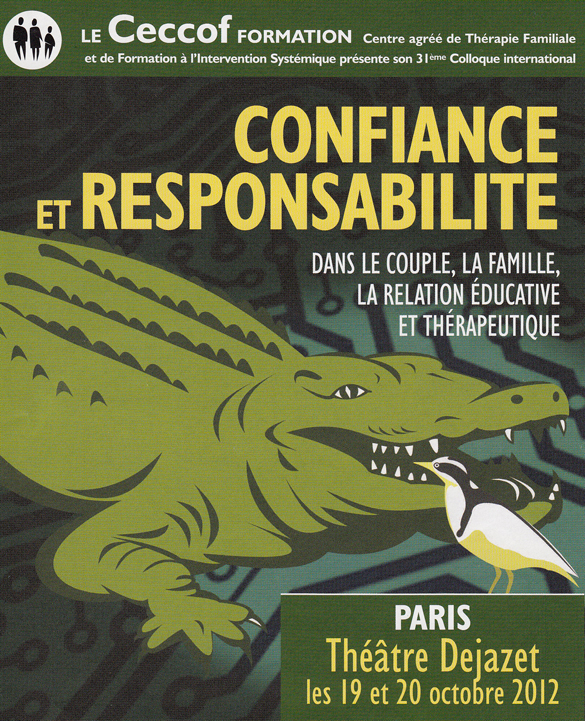Mon intervention au colloque 2012 du Ceccof
« Développez votre étrangeté légitime » disait René Char. Et si le poète avait raison ? Faut-il lui faire confiance ? Inventer notre étrange singularité, est-ce cela la grande responsabilité qui nous engage vis-à-vis des autres autant que de nous-mêmes et du monde ? A travers une brève histoire de la philosophie nous interrogerons ces deux concepts et nous nous demanderons comment les mettre à l’œuvre dans notre pratique professionnelle.
Retrouver le sens philosophique de ces deux concepts
En entendant la juxtaposition de ces deux concepts, il y a de quoi se sentir écrasé par un certain poids moral. Et cela peut surprendre de la part du Ceccof, ce n’est en général pas notre ligne épistémologique que d’évoquer la morale, nous avons plutôt tendance à nous en méfier. L’année dernière, très clairement, avec notre travail sur les mauvais sentiments nous avions dénoncé ce que P. Nora appelle le déchaînement « vertuisme » contemporain. Nous avons démontré le côté pervers de la valorisation à outrance de la bienpensance, de la morale. En effet, il y a une réelle contradiction entre, d’un côté, le triomphe d’une vision moraliste du monde et, de l’autre, la banalisation du mal. Alors cette année avons-nous eu des remords, voulons-nous nous racheter une conscience morale toute neuve ?
En fait, il faut éviter le risque de contre-sens : il y a une différence importante entre le sens commun et le sens philosophique de ces deux notions. En partant à la découverte de leur sens philosophique, nous allons y trouver à la fois bien plus de souplesse et de légèreté que la doxa voudrait y mettre, mais aussi une cohérence intéressante dans la mise en perspective de ces deux notions – confiance et responsabilité.
Je vous propose donc de cheminer à travers le champ philosophique. Une promenade rapide et tout à fait rafraîchissante dans l’histoire de la philosophie ne nous fera pas de mal en ce vendredi matin et nous permettra de faire éclater le sens premier que la doxa impose.
Le sens commun en effet accorde une dimension morale très forte à la responsabilité et à la confiance. Or les philosophes surtout modernes, sont un peu plus cool. Ils vont nous emmener de l’éthique à l’esthétique, en passant par la poésie.
Évidemment, au bout du compte, vous ne saurez plus du tout ce qu’est la confiance ni la responsabilité. Et c’est ainsi que tout ira bien. Un rabbin conseillait « ne demande pas ton chemin à quelqu’un qui le connaît, sinon tu ne pourras pas t’égarer » donc si, chemin faisant, vous vous sentez un peu perdus, c’est que vous êtes vraiment en train de devenir de véritables philosophes.
La responsabilité, de la prudence à la liberté
Pour le sens commun être responsable cela renvoie à la notion de devoirs liés à une position, à une fonction donnée, on l’exerce de manière responsable, nous dit-on, si on respecte nos engagements, et que l’on répond correctement à ce qu’on attend de nous. Pour la doxa donc, la responsabilité est un devoir faire, alors que pour la philosophie ce sera d’avantage un « être capable d’être », ou plus exactement « devenir capable d’être ».
En droit aussi la responsabilité est importante. On interroge la notion d’intention. Le préjudice, le crime, a-t-il été fait avec préméditation ou non. Le coupable était-il conscient, en pleine possession de ses moyens quand il a agi ou non ? A-t-il agi par ignorance, par erreur, négligence, imprudence ? Quelle est sa part de responsabilité, c’est à dire son implication ? Et par rapport à son degré de responsabilité, quelle sera sa sanction ? Elle ne sera pas de même teneur s’il n’a fait qu’assister, sans porter secours, ou si il a été actif, instigateur. On sait à quel point ces débats sont difficiles à trancher.
Le questionnement philosophique est encore plus troublant, on pourrait le résumer comme tel : Comment répondre des conséquences imprévisibles, de mes actes mais aussi de mes omissions, conséquences qui vont souvent bien au-delà de mes intentions. Jusqu’où suis-je engagé envers autrui, et de quoi suis-je vraiment responsable ?
La responsabilité pourrait à première vue donner une impression de vertige, car je serai responsable au-delà même de mes intentions, et responsable à la fois de ce que je fais, mais de ce que je ne fais pas, de ce que je ne dis pas. Il y aurait comme une démesure de la responsabilité. Mais cette démesure une fois posée, c’est justement ce puits sans fond que l’histoire de la philosophie va discuter, cherchant à introduire une mesure à ce qui se présente comme incommensurable.
En philosophie, la responsabilité fait débat finalement depuis assez peu de temps. C’est un concept relativement récent dans l’histoire de la philosophie, comme si pour les anciens, il allait de soi qu’on devait se montrer responsable c’est à dire raisonnable, faisant appel à notre raison, plutôt qu’à nos passions, affects.
Notre cher Aristote a posé les bases de cette mesure nécessaire, et cela n’a pas été beaucoup requestionné jusqu’aux philosophes modernes.
Aristote en appelle à la Prudence. En tout bien, tout honneur, il commence par confirmer l’idée que la rigueur est de règle dans l’analyse de la responsabilité. Le « je ne savais pas », « je n’aurais pas imaginé » a beau être de bonne foi, il est signe de « mauvaises habitudes », de mauvais penchants. Mon inconséquence signe un relâchement moral inacceptable et condamnable. Toute conduite vertueuse doit se faire sous l’égide de la réflexion, et de la raison qui doivent me permettre d’anticiper au maximum les conséquences possibles.
Donc oui, on est responsable au-delà de nos intentions, mais Aristote est un homme raisonnable qui s’applique à lui-même ce qu’il enseigne. Il modère cette rigueur en expliquant que finalement le but de la philosophie, c’est le bonheur personnel et collectif dans la cité, et il évoque la morale pratique que l’on nommerait aujourd’hui éthique, le comment mettre réellement en œuvre, en acte, les beaux principes moraux. Il fait appel alors à la prudence, ne nous engageons que dans ce que nous nous estimons capables de faire. Limitons de manière réaliste nos exigences vis à vis de nous-mêmes. En un mot, prenons en compte nos limites, notre impuissance, notre vulnérabilité.
Pour Aristote, la Prudence est une vertu cardinale, c’est à dire qu’elle fait partie des 4 vertus piliers avec la justice, la tempérance, le courage. La prudence, c’est véritablement la vertu de l’intelligence pratique. Un des éléments central de la prudence c’est la délibération, le discernement qui permet d’évaluer si ma conduite est la plus adaptée. « L’acte vertueux consiste à faire ce que l’on doit, pour quoi on le doit, comme on le doit. » Ainsi, en étant prudent dans ses engagements, on est encore plus vertueux.
Ouf, si Aristote nous dit qu’il faut éviter de nous mettre à nous-mêmes la pression, c’est plutôt encourageant.
Sautons à pieds joints dans la philosophie moderne. Ce qui est intéressant avec les philosophes modernes, c’est la polysémie de sens qu’ils font émerger à partir de ce concept.
Paul Ricœur nous invite à faire les comptes. C’est donc un philosophe que j’aime bien, car il reconnaît l’importance des comptes dans les rapports humains.
Ricœur parle davantage d’imputabilité. A qui peuvent être imputés et mes actes et mes omissions ? L’imputabilité renvoie à un sujet comptable de ses actes, au point de se les imputer à soi-même, il accepte les conséquences de ses actes car c’est un sujet engagé dans le processus de reconnaissance, il se reconnaît comme acteur de ses gestes, auteur de ses paroles. Le parcours de la reconnaissance, c’est le parcours de sa responsabilité.
Qui parle ? Qui agit ? Qui raconte ? Le « Je » va se construire en tant qu’il est capable de se reconnaître comme acteur de ses gestes, auteur de ses paroles. En répondant « me voici », en répondant de sa présence au monde, on renforce son être.
Pour lui, l’essentiel est de convertir l’homme coupable en homme capable. Qu’est-ce que cela veut dire ? Le but, en philosophie, n’est pas de chercher la culpabilité de tel ou tel homme, mais de l’amener à devenir capable de répondre de soi devant les autres, et aussi rendre au « Je » la capacité de vouloir vivre, et de vouloir bien vivre.
L’étymologie du mot va nous permettre de faire le lien entre Ricoeur, et Levinas : responsable – adjectif – est apparu en français vers le 13e siècle, vient de respondere ; il signifie répondre De, il prend rapidement le sens de « qui doit rendre compte de ses actes ». Ce n’est qu’au 20e siècle que le substantif apparaît, « le responsable » au sens de porter la responsabilité de ses actes.
Emmanuel Levinas, les conditions de la rencontre éthique
Si pour Ricœur, un sujet doit répondre de lui-même, pour Levinas, il s’agit plutôt de répondre à. Et de répondre à ce qui ne se donne même pas à entendre, à ce qui est au-delà de toute parole – l’infinie responsabilité qui me lie à autrui. Car pour Levinas, la responsabilité nous engage envers autrui bien au-delà de ce que l’on peut décider, choisir : « l’éthique serait cette dette que je n’ai jamais contractée » « c’est malgré moi qu’Autrui me concerne ». L’altérité s’éprouverait alors dans un vertige, le vertige de l’immense responsabilité que j’ai vis à vis de l’autre. « Autrui est un centre d’obligations pour moi », disait-il.
C’est un peu effrayant, et c’est souvent cette altérité démesurée que l’on retient de Levinas. Se pourrait-il qu’il transgresse la règle aristotélicienne de prudence ? Rassurons-nous, non.
A y regarder de plus près, pour lui le plus important, c’est la rencontre éthique, rencontre qui se fonde dans le face à face de deux visages qui s’affirment dans leur singularité.
Le visage, c’est ce qui ne se laisse pas enfermer dans les visages que son histoire, ses contextes lui donnent, lui ont donné. Elle se produit quand j’accepte de découvrir l’autre au-delà de ce que je crois connaître de lui.
Le visage s’impose alors dans son altérité irréductible.
Mais, nous dit Levinas, cette rencontre n’est pas seulement révélatrice d’autrui, elle me fonde moi aussi dans ma singularité, elle est faite aussi pour me faire du bien. Quand je parviens à considérer autrui comme échappant à mon pouvoir, à mon soi-disant savoir ou connaissance, je le considère comme une liberté extérieure à la mienne, et par là même, cette considération marque ma présence singulière au monde. « Quand le moi tient compte de ce qui n’est pas lui, et en même temps ne s’y dissout pas, dans ce rapport à la fois de participation et de séparation, alors il y a rencontre. La condition de la pensée, c’est la rencontre morale ». « Reconnaître autrui, c’est croire en lui » mais cette reconnaissance n’est pas soumission : « le visage qui me regarde, m’affirme »
Ainsi quand je parviens à être pour l’autre, avec l’autre, je suis aussi avec moi, pour moi, encore davantage.
Comment rendre possible cette rencontre ? Trois pistes à retenir :
– la rupture de l’indifférence, c’est quand je me sens concerné par autrui, par sa singularité que je deviens responsable, non pas de lui, mais des conditions d’émergence de cette singularité. Finalement, il serait plus exact de parler de rupture de l’indifférenciation.
– pour préserver cette extériorité réciproque, cette liberté réciproque, il est indispensable de faire appel à la non substitution des individus. « Chaque moi n’est pas interchangeable. Ce que je fais, personne d’autre ne peut le faire à ma place. Le nœud de la singularité, c’est la responsabilité. » On est responsable de se reconnaître mutuellement comme des êtres uniques non substituables.
– La rencontre passe par la capacité de regarder le monde avec les yeux d’autrui. « Le partage du monde s’effectue à partir du moment où on le regarde avec les yeux de l’autre. »
Michel Foucault nous invite à être des artistes et des artisans, soyons les sculpteurs de notre propre existence.
L’homme chez Foucault se perçoit d’emblée comme un être dépendant, il est lié à des systèmes de pensée, inscrit dans certains ordres de discours, assujetti à des dispositifs de pouvoir. Différent de Sartre pour qui l’homme se découvre dans l’angoisse, comme liberté. Cette dépendance est ontologique, et non liée à une situation sociale donnée. L’homme reçoit son identité des jeux de savoirs qui s’imposent comme des vérités et de pouvoir qui organisent la société. Il en hérite. Quand il ne les questionne pas, il les reproduit. Foucault note le danger de tout ce qui se répète. La dépendance de l’homme n’est pas un destin, et c’est le rôle du philosophe que de troubler les évidences et de se déprendre des idéologies. Si l’histoire nous fait, on peut la faire à notre tour.
Cette dépendance appelle une exigence, celle d’un affranchissement. Il reprend une jolie phrase de René Char : « Développez votre étrangeté légitime. »
Pour Foucault, l’homme est en charge de sa propre existence. Il doit la produire comme un art de l’existence, à travers laquelle il manifeste ses valeurs qui sont en même temps des valeurs pour les autres.
Pour lui, l’homme est a-venir, il a à s’inventer. Il n’a pas à se libérer d’un refoulé, mais plutôt des identités qui lui sont conférées, il doit se produire lui-même.
Et pour cela il doit travailler sur lui-même, et s’appliquer des techniques, mais au sens premier du terme :
Technos : ce qui concerne un art- techné : art manuel.
Pour devenir le propre sculpteur de lui-même et de son existence, au même titre qu’un sculpteur travaillant à sa création.
« Faire de sa vie une œuvre qui porte certaines valeurs esthétiques. Il a appelé cela « les arts de l’existence ».
Mais en définissant ainsi la responsabilité, comme devant nous libérer des pouvoirs, des savoirs sclérosant pour nous placer selon des valeurs personnelles, il la rend synonyme de auto-nomie (auto : soi-même / nomos : loi). L’autonomie, c’est le fait d’obéir à une loi qu’on s’est donnée à soi-même, par opposition à l’obéissance aveugle à des lois externes. L’autonomie est un long processus qui se construit tout au long de sa vie et qui répond à la question : A quoi je décide d’obéir ?
Nous arrivons donc aux termes de cette balade dans les terres de la responsabilité sur un paradoxe que nous pourrions énoncer ainsi : iI n’y a pas de responsabilité sans liberté, et assumer ses responsabilités rend libre et autonome.
La confiance à l’origine de l’identité ?
Qu’en est-il de la confiance, et qu’a-t-elle à voir avec la responsabilité ? On pourrait énoncer la question philosophique à propos de la confiance de la manière suivante : La confiance est-elle vraiment utile ? A qui la confiance profite-t-elle ?
En cheminant, nous comprendrons peut-être en quoi la confiance peut être à l’origine de l’identité.
Je vous propose de faire dialoguer devant vous trois philosophes.
Kant, ou de l’utilité de la confiance
Pour Kant, pas de doute, la question de la confiance est fondamentale. « Dans un monde où la confiance n’existe pas, les devoirs de loyauté tombent en désuétude. » (Mét. des mœurs). Tout s’écroule, le lien social, les institutions politiques, les liens entre individus quand il ne peut y avoir de confiance. Pour que le lien social soit possible, nous devons chacun d’entre nous efforcer d’être dignes de confiance, mais pas seulement.
Pour Kant, la confiance s’élabore dans la force morale et impérative de la parole donnée. « Je m’engage à tenir parole» suppose que « tu t’engages à ton tour ». Tous les impératifs catégoriques de Kant pourraient être interprétés comme l’injonction de se montrer digne de confiance. Mais l’impératif le plus catégorique rejoint la prudence : ne pas faire de fausses promesses, bien mesurer ce sur quoi on peut s’engager ou non.
La confiance comme la responsabilité impliquent donc la prudence, mais aussi la réciprocité. Cette réciprocité est fondamentale, elle suppose un engagement respectif. La confiance engage et lie les deux partenaires, celui qui est dépositaire de la confiance mais aussi celui qui se fie à l’autre. La responsabilité se trouve être partagée, elle se trouve être engagée des deux côtés. De quelle manière ?
Évidemment celui qui est dépositaire de la confiance est responsable devant les autres et de lui-même de ne pas la trahir, de répondre aux attentes, mais la construction de la confiance tient encore davantage à l’esprit responsable de celui qui accorde sa confiance. Celui qui accorde sa confiance doit assumer son choix, et ne s’en prendre qu’à lui-même s’il s’est trompé, s’il s’est laissé berné. Il doit assumer la responsabilité de son choix, en répondant de lui-même et de son discernement.
Autant il faut être digne de la confiance de l’autre, autant il n’est pas obligatoire d’accorder sa confiance, nous dit-il. Prudence, prudence ! Rien ne nous oblige à faire confiance à, de manière inconsidérée. Il y a comme une asymétrie dans l’engagement, si quelqu’un m’accorde sa confiance, je ne peux pas le décevoir, mais à mon tour, je dois regarder de très prés avant d’accorder ma confiance.
En fait, il s’agit davantage de défiance, de méfiance que de prudence, on est un peu au-delà de la simple prudence.
On pourrait dire de manière paradoxale, la confiance ne s’institue qu’à partir d’une défiance nécessaire. Méfions nous les uns les autres, serait le précepte premier de toute « prise de confiance ». Avant d’accorder notre confiance à quelqu’un, mesurons sa capacité à répondre de, et à répondre à.
Hume, soyons réalistes
Car oui, accorder sa confiance à quelqu’un lui donne un certain pouvoir sur nous. Faire confiance, c’est s’en remettre à l’autre, et cela nous place dans un premier temps, dans un état de vulnérabilité, je ne sais pas si l’autre est fiable, s’il honorera la confiance que je lui fais. Est-il digne de confiance, est-il capable d’assumer cette responsabilité qui l’engage vis à vis de moi. La confiance est un exercice périlleux, c’est un pari qui nous situe entre le savoir et le non-savoir ; je suppose que je peux faire confiance, mais rien n’est sûr. La confiance en l’autre suppose une certaine forme d’abandon de pouvoir, de contrôle temporaire, pendant un laps temps où, précisément, j’ignore quelle valeur a pour l’autre la confiance que je lui accorde, et cela se rejoue à chaque instant.
La confiance est un crédit fait aux autres, on suppose qu’il a « tout intérêt » à ne pas trahir, elle est le fruit d’une longue série d’interactions répétées. Évidemment, longue à installer, elle peut s’évanouir en un seul geste !
Hume se demande pour quelle raison on aspire à respecter la confiance qui nous est faite ? Est-ce pas pur altruisme ? Il est trop réaliste pour y croire. Pour Hume, si je tiens mes promesses, si je demeure fiable, ce n’est pas par respect de l’autre mais avant tout pour sauver sa réputation, en un mot par intérêt personnel. Honorer la confiance est bien sur une obligation morale, mais elle est toujours accompagnée d’une obligation intéressée.
Il est donc raisonnable de se fier à quelqu’un qui se soucie de sa réputation, qui a à cœur de rester honorable.
Méfions-nous de tout angélisme.
Ricœur, ou le temps des promesses
Pour Paul Ricœur la confiance se fonde sur la capacité à tenir ses promesses.
Il explore la promesse sur le plan ontologique. Que se passe-t-il pour mon être, pour moi-même quand je suis engagé par une promesse ? Dans la promesse j’engage qui je suis. Il y va ni plus ni moins de mon être propre.
La promesse m’engage ontologiquement, c’est dans un au-delà de ce que je suis aujourd’hui que je m’engage à tenir parole. J’anticipe mon être de demain, cela me projette dans un A-venir de moi-même encore inconnu.
Dans le processus de la promesse s’opèrent deux mouvements. Je m’engage maintenant pour une promesse que je tiendrai tout à l’heure. Mais en même temps, autrui s’attend à ce que je reste fidèle à cette promesse pour tout à l’heure. Pour accomplir la promesse, il faut à la fois que je reste moi-même mais que je devienne autre par le fait même de faire quelque chose de nouveau pour moi. Je me maintiens dans qui je suis de telle manière que l’autre peut compter sur moi.
Je maintiens qui je suis, tout en devenant un autre, l’autre que je serai demain. La promesse permet ce formidable tour de passe-passe de l’être, rester soi même à travers le temps. La promesse permet d’articuler ipséité et mêmeté. (Mêmeté : je demeure le même, malgré les temps qui changent, et ipséité, je ramène à moi, ce qui change en moi, je me reconnais moi malgré les changements que je subis).
Dans cette promesse tenue, le soi atteste de sa permanence et de sa fluidité, sa capacité de changer.
Par conséquent, la promesse renforce la confiance en soi : elle renvoie à l’assurance confiante d’être soi. Le soi se reconnaît, il se sent être, il se perçoit comme vivant, dans cette permanence à travers les changements.
Ainsi, là aussi, faire des promesses et les tenir, c’est tout bénéfice pour le Soi, le je.
Cela tient aussi au fait que confiance et responsabilité sont des postures qui sont proches du don. Comme lui, ce sont des attitudes d’ouverture vers autrui, mais qui en même temps nourrissent, enrichissent celui qui donne, donne sa confiance, ou donne sa parole. Il y a un retour immédiat sur soi-même, un bénéfice rassurant, structurant, narcissisant sur soi-même.
Cela nous permet de conclure sur une note optimiste.
Conclusion : confiance et responsabilité sont les vertus de l’optimisme
On pourrait ainsi en effet conclure que confiance et responsabilité sont les vertus de l’optimisme, un optimisme évidemment tout sauf niais et béat, mais calculé de manière prudente.
La confiance en effet, est un pari sur l’avenir, elle est sous-tendue par l’espoir que le bien l’emporte sur la crainte du mal possible.
La responsabilité est une projection dans le futur. Être responsable, c’est croire en soi, en sa capacité d’assurer, c’est s’engager pour que le futur soit meilleur.
Entre ces deux processus on voit bien se dégager une synergie positive et créatrice. Se fier à c’est croire en l’autre, c’est espérer en son humanité, c’est lui permettre d’accéder à sa dignité. Dans des jeux de miroir où chacun s’affirme dans la réciprocité de l’altérité.
Confiance et responsabilité créent donc la vertu de l’espérance, de l’espoir du mieux vivre. Ce sont des vertus optimistes, c’est en ce sens qu’on en a le plus besoin.